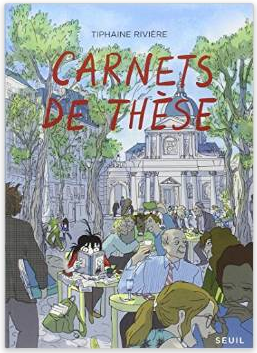
Jeanne Dargan a 27 ans, elle est prof de collège en ZEP et franchement, elle n’en peut plus. Alors, même si on lui a refusé un financement, elle décide de se lancer dans une thèse sur « Le motif labyrinthique dans la parabole de la loi du Procès de Kafka ». Pleine d’enthousiasme, elle décrète qu’elle bouclera son travail en trois ans jour pour jour, et que son compagnon Loïc et elle seront le couple sur trois qui n’explose pas en vol pendant que l’un des deux partenaires est doctorant.
Puis la secrétaire met un maximum de mauvaise volonté à traiter son dossier; on lui refile des cours sur une matière qu’elle ne maîtrise pas; l’université refuse de la payer; sa famille la prend pour une grosse glandeuse et son directeur de thèse ne répond pas à ses mails. Après des mois de procrastination pure, Jeanne se décide enfin à se mettre au travail. Elle case 64 heures de recherche par semaine à côté de son boulot à mi-temps, ne parle plus que de sa thèse, ne rêve plus que de sa thèse – mais passe tellement de temps à modifier son intitulé et son plan que deux ans plus tard, elle n’a toujours pas entamé la rédaction…
Autrefois, Tiphaine Rivière a tenté une thèse de littérature, et lâché l’affaire au bout de trois ans pour ouvrir un blog illustré: « Le bureau 14 de la Sorbonne » (sur lequel vous pouvez lire les premières pages de sa bédé). Elle sait donc très bien de quoi elle parle, et ses « Carnets de thèse » sentent le vécu à plein nez. Bien que raconté avec beaucoup d’humour, ce parcours de la combattante a quelque chose d’effrayant, non seulement à cause des obstacles administratifs rencontrés par Jeanne, mais surtout à cause de l’enfermement, du repli sur soi, du doute perpétuel auxquels la condamne son travail – tout ça pour, à la sortie, des débouchés plus que discutables dans sa branche. « Carnets de thèse » aurait pu s’appeler « Récit d’une aliénation volontaire ». Malgré son ton léger et le plaisir que j’ai pris à le lire, sa fin me laisse sur un vague sentiment de gâchis humain.
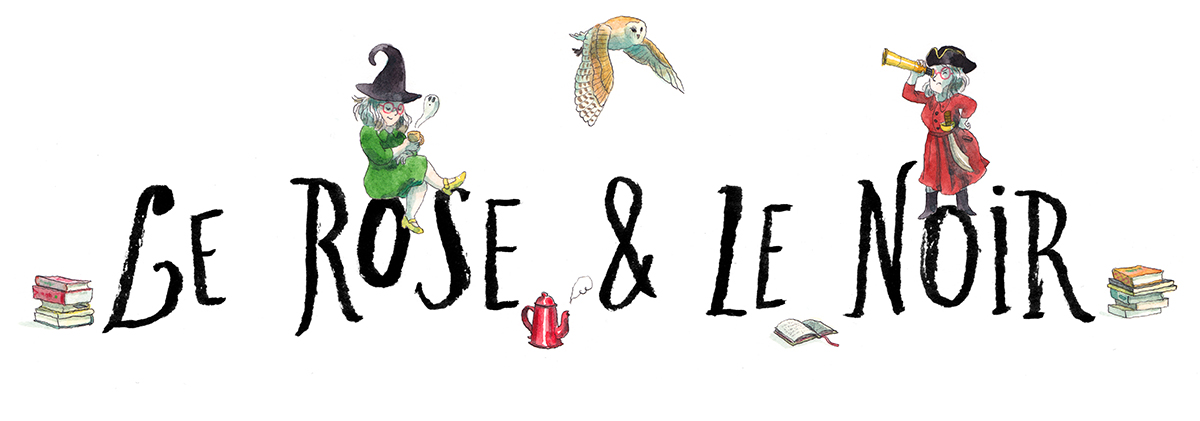
Moi qui hésite toujours à m'y mettre…
Eh bien, cela me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de ne pas franchir le pas, au moment où j'aurais pu le faire (quoiqu'il n'est jamais trop tard)
Bon cela dit, ce n'est que la vision d'une personne 🙂 Il doit bien exister des gens qui sont ravis d'avoir fait une thèse. Et il me semble aussi, d'après les exemples que j'ai autour de moi, que l'expérience varie énormément selon les matières. J'ai l'impression que les doctorants dans des matières scientifiques font toujours des trucs hyper intéressants, par exemple (mais c'est peut-être parce que je ne comprends même pas le titre de leur thèse!)
Je vais peut être me laisser tenter, le monde des universitaires littéraires m'a toujours fasciné.
J'ai fait une thèse en géologie (en trois ans), c'était intense mais je ne regrette absolument pas. Mais je pense qu'il y a autant d'avis que de thésard ! La grande question c'est l'après-thèse, et je songe moi même passer le concours d'instit alors comme quoi …
Je redoute de lire ces carnets tant j'ai peur que cela ne soit le reflet de ce que j'ai vécu – aussi pour une thèse littéraire – car je ne suis pas encore sûre d'avoir suffisamment de recul pour le prendre avec humour ^^
Moi je suis passée par ce parcours du combattant, en littérature. J'ai la chance d'avoir un poste à l'université, seul vrai débouché. Mais si on prend en compte (en littérature) le taux de thèses non abouties, puis le nombre de thèses non qualifiées (étape obligatoire pour se porter candidat à un poste), enfin le nombre de docteurs sans postes, eh bien, on se dit qu'il faut être fou pour se lancer. Tout ça pour dire que quelles que soient les qualités de cette bande dessinée, je ne la lirai pas, elle est trop proche de ce que j'ai vécu et observé autour de moi : le gâchis humain, comme tu dis. Mais je comprends que l'auteure ait voulu sortir quelque chose de créatif et de positif de cette expérience!
Connaissant bien ce milieu, j'ai pris grand plaisir à lire cette BD que j'ai forcément trouvée très réaliste ! Mais c'est vrai que la notion de "gachis humain" que tu évoques est fort à-propos !
Comme d'autres ici, je ne lirai pas cette BD qui semble trop proche de la réalité, trop réalistes concernant les mauvais points que je voudrais oublier… Pourtant, je suis Docteur en Biologie, pas du tout en littérature. Mais ce titre ma pourri la vie, et m'a entrainé dans une dépression dont que m'extirpe enfin, un an plus tard.
Il y a effectivement des thésards et des Docteurs heureux et fières de leur thèse (mon compagnon en est un bon exemple, et sans doute que notre couple n'a pas explosé en vol comme beaucoup d'autres parce que nous étions tout les deux dans la même galère), il y a effectivement de grosses différences (moyens alloués, financements, encadrements des superviseurs, reconnaissance de l'entourage, etc) en fonction des domaines de recherches, des organismes de financement ou des universités encadrantes, et un seul avis ne représente pas la réalité. Mais pour ma part, ma thèse à été un très bel exemple de "gâchis humain" qui laisse un goût amère.