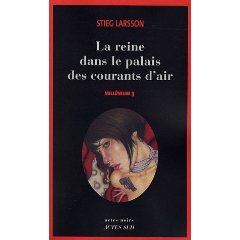 Autant le dire franco: je n’ai guère aimé ce troisième et dernier tome de Millénium.
Autant le dire franco: je n’ai guère aimé ce troisième et dernier tome de Millénium.
Déjà, le deuxième m’avait moins plu que le premier. Certes, découvrir le passé de Lisbeth Salander était intéressant, mais le milieu de la traite des femmes dans lequel Mikael Blomkvist enquêtait me passionnait beaucoup moins que les histoires de la famille Vanger, et l’atmosphère urbaine de Stockholm me semblait bien banale après l’âpreté glaciale du nord de la Suède.
Il se trouve que « La reine dans le palais des courants d’air » reprend l’histoire directement là où elle s’est arrêtée à la fin de « La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une boîte d’allumettes ». Il n’y a donc pas de nouveau mystère à débrouiller – à part peut-être l’identité du mystérieux stalker d’Erika Berger, pendant quelques chapitres. Au lieu de ça, on assiste aux enquêtes croisées de différentes factions qui se contentent de reconstituer péniblement les faits dont le lecteur est déjà au courant. Niveau scénario, ça devient très vite lourd et répétitif. On se perd dans les méandres de l’organisation de la Sapö (la police secrète suédoise), et on se farcit tout un tas de considérations sur les rouages gouvernementaux qui m’ont prodigieusement ennuyée. Reste le style toujours agréable à lire; c’est sans doute, avec ma curiosité quant au dénouement, la seule chose qui m’a poussée à finir le bouquin.
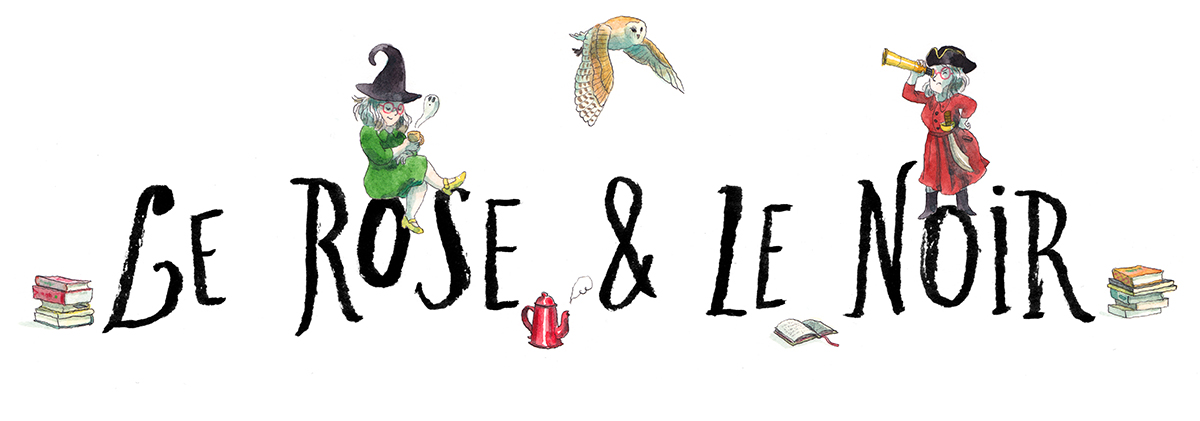
Je n'ai jamais réussi à terminé ce dernier opus. Trop de longueurs à mon goût.